Accélération de l'Initiative d’élimination des maladies
Chapitre 4. Comment accélérer les efforts d'élimination dans la Région

Résumé
L'expérience cumulée de l'OPS et des États Membres en matière d'élimination des maladies a permis d'acquérir des connaissances essentielles sur les stratégies intégrées d'élimination. Bien que la mise en œuvre et le contexte varient, toutes les stratégies discutées comportent un potentiel d'accélération accrue. Les approches clés couvrent les quatre axes d'intervention de l’Initiative d’élimination des maladies et incluent des stratégies telles que le renforcement du premier niveau de soins, l'appui à l’innovation et à l’accès aux technologies de la santé et aux systèmes de données, l’élaboration d’interventions axées sur l’équité, et la participation de la société civile. Les États Membres sont encouragés à adopter et à intensifier ces stratégies efficaces, afin d’atteindre leurs cibles d'élimination et de fournir des soins plus équitables, centrés sur la communauté et sur la personne.
Renforcer l'intégration des systèmes de santé et de la prestation des services (AXE D'INTERVENTION 1)
Approche : intégration de multiples maladies au premier niveau de soins
Pourquoi est-ce important ?
Le premier niveau de soins (également appelé soins primaires) est essentiel pour l’élimination des maladies, car il offre la vaccination, le dépistage, le diagnostic et le traitement. Il offre aussi la possibilité de mettre l’accent sur l’équité et d’aborder l’élimination des maladies selon l’approche du parcours de vie. Le premier niveau de soins est la pierre angulaire de la stratégie des soins de santé primaires, qui renforce les systèmes de santé et s’appuie sur des politiques et des actions multisectorielles. La mise en œuvre de la stratégie des soins de santé primaires peut appuyer l’engagement des communautés et leur participation à leurs propres soins, en respectant leurs besoins et leurs exigences.
Que fait-on actuellement ?
L’initiative pour l’élimination de la transmission mère-enfant Plus (ETME Plus) a été établie en 2016 pour éliminer la transmission mère-enfant du VIH, de la syphilis, de la maladie de Chagas et de l’hépatite B, en priorisant le premier niveau de soins. L’EMTCT Plus a conduit à des résultats mesurables. Par exemple, les taux de transmission mère-enfant du VIH sont passés de 22 % en 2010 à 16 % en 2019 en Amérique latine et de 21 % en 2010 à 13 % en 2019 dans les Caraïbes (avant d’augmenter légèrement dans ces deux sous-régions lors de la pandémie de COVID-19). Il a également été constaté une diminution de 40 % des nouvelles infections au VIH chez l'enfant (1). Onze pays et territoires situés dans les Caraïbes (Anguilla, Antigua-et-Barbuda, Belize, Bermudes, îles Caïman, Cuba, Dominique, Jamaïque, Montserrat, Saint-Kitts-et-Nevis et Saint-Vincent-et-les Grenadines) ont éliminé la transmission mère-enfant du VIH et de la syphilis, grâce à la mise en œuvre réussie de l’EMTCT Plus. Le Belize, la Jamaïque et Saint-Vincent-et-les-Grenadines sont les derniers pays de la Région à avoir reçu la certification de l’OMS pour l’élimination de la transmission mère-enfant du VIH et de la syphilis. Pour atteindre les cibles d’élimination, ces pays ont ciblé le renforcement des services de prévention, de dépistage et de traitement au premier niveau de soins (2).
Une autre stratégie pour mettre en œuvre au premier niveau de soins des approches intégrées comme l’EMTCT Plus consiste à former des agents de santé communautaires. Contribuant ainsi à remédier aux pénuries de personnel de santé, les agents de santé communautaires peuvent fournir des services de base, tels que la vaccination, le dépistage des maladies, l’éducation en matière de santé, les soins prénatals et la surveillance. Par exemple, le programme national de lutte contre le paludisme du Suriname inclut le diagnostic et le traitement par des agents de santé communautaires des cas de paludisme non compliqué, principalement dans les zones difficiles d’accès et dans les communautés mobiles de migrants (3). Les agents de santé communautaires ont également joué un rôle essentiel en Haïti lors de la riposte à la flambée épidémique de choléra de 2022-2023, en fournissant une éducation à la prévention, le traitement initial, des orientations et un soutien en matière de surveillance (4). De même, les agents communautaires de santé animale appuient les initiatives qui s’alignent sur la stratégie « Une seule santé » de l’OPS aux fins de lutte contre les zoonoses.
Comment les pays peuvent-ils accélérer les progrès ?
Les stratégies de soins de santé primaires nationales doivent atteindre les communautés où persiste une transmission de certaines maladies et, pour cela, s’attaquer notamment à des problèmes tels que la méfiance, l’insuffisance des approches interculturelles et les barrières linguistiques (5). De même, les pratiques efficaces de programmes existants tels que l’initiative EMTCT Plus peuvent être intensifiées pour renforcer le premier niveau de soins, en veillant à ce que des services comme les soins prénatals et la vaccination soient mis à disposition de manière élargie. L’amélioration des programmes de santé numérique peut également élargir l’accès. Par exemple, de nombreux pays ont eu recours à la télémédecine pour répondre à la demande de services de santé lors de la pandémie de COVID-19. En Colombie, 100 millions de personnes ont utilisé la télémédecine au cours de la première année de COVID-19 (6) et, au Pérou, un effort multisectoriel a permis de fournir des services de télémédecine à huit communautés autochtones isolées d’Amazonie (7). Pour généraliser ce type d’intervention, les pays doivent d’abord se préoccuper de l’accès à la technologie et mettre en œuvre des réglementations juridiques en matière de confidentialité (8).
L’un des principaux défis du premier niveau de soins est de disposer d’un personnel de santé suffisant. Or, non seulement la disponibilité du personnel est insuffisante pour assurer la prestation efficace de services intégrés, mais le système actuel n’appuie pas une approche par équipe multiprofessionnelle, dans laquelle divers professionnels de la santé (par exemple, personnels médical, infirmier, pharmacien, et de travail social) collaborent pour offrir une gamme complète de services. Les États Membres peuvent remédier à cet état de fait en consacrant davantage de ressources à l’embauche et à la formation d’un personnel élargi et en appuyant au premier niveau de soins une approche globale fondée sur le travail en équipe.
Approche : amélioration de l’innovation et de l’accès aux technologies de la santé
Pourquoi est-ce important ?
Les technologies de la santé, notamment les vaccins, les produits de diagnostic et les traitements, sont essentielles pour réduire la charge des maladies transmissibles. Cependant, une série de difficultés bloquent l’accès à ces fournitures, notamment le manque de travaux de recherche-développement, la problématique de la chaîne de distribution dans les zones reculées, les ruptures de stock, les prix, les exigences réglementaires, les contraintes de financement, l'insuffisance des infrastructures d’approvisionnement et l'absence de production régionale. Ces facteurs peuvent entraîner des pénuries et des retards d’accès, et réduire l'efficacité réelle des ressources de santé essentielles. La décentralisation des achats au niveau national peut aggraver ce problème, car les zones de petite taille ont souvent un pouvoir d’achat insuffisant, ce qui entraîne des disparités de disponibilité de certaines fournitures, même au sein d’un même pays.
Que fait-on actuellement ?
L’OPS et les États Membres travaillent sur diverses initiatives qui contribuent à répondre aux besoins actuels et futurs en matière de santé, à réduire les iniquités dans la Région et à favoriser le développement économique. Les Fonds renouvelables régionaux de l’OPS offrent un accès abordable et rapide aux fournitures. Ils améliorent également la gestion de l’approvisionnement, aident à la planification de la demande et préviennent les ruptures de stock. On estime que 180 millions de personnes ont bénéficié de fournitures de santé acquises via ces fonds au cours des deux dernières années. Le département Innovation et accès aux médicaments et aux technologies de la santé de l’OPS, et son programme spécial Plateforme d'innovation et de production régionale, renforcent les capacités d’innovation, de mise au point et de production des technologies de la santé.
L’OPS contribue également à améliorer la disponibilité et l’accessibilité économique des médicaments et des technologies sanitaires. Il s’agit notamment d’aider les États Membres à évaluer, à intégrer, à réglementer, à gérer et à utiliser en toute sécurité ces technologies. L’Organisation travaille aussi avec les pays à renforcer la compétitivité des produits génériques et biosimilaires, et d’autres politiques et stratégies visant à améliorer l’accès aux médicaments.
Comment les pays peuvent-ils accélérer les progrès ?
L’accès aux technologies de la santé nécessite un système global qui couvre leur cycle de vie, de leur conception à leur distribution et à leur utilisation rationnelle. De plus, on ne dispose pas des technologies nécessaires pour certaines maladies, comme la maladie de Chagas pour laquelle on est confronté à des défis de diagnostic. L’efficacité des tests actuels est en effet limitée, quels que soient la souche de l’agent pathogène et le stade de l’infection. L’amélioration des technologies de détection pourrait beaucoup accroître les taux de diagnostic et de traitement (9). Pour faire progresser les travaux de recherche-développement, il faut une volonté politique, des financements, des politiques et des réglementations de soutien, ainsi qu’une recherche de solutions innovantes. Par exemple, élargir l’utilisation du double dépistage pour le VIH et la syphilis dans les services de santé de la mère et de l'enfant et promouvoir le dépistage rapide du paludisme sont des interventions qui peuvent respectivement accélérer l’élimination de la transmission mère-enfant et celle du paludisme. L’autodépistage pour l’infection au VIH, l’infection au VPH, les infections sexuellement transmissibles et l’hépatite C, disponible dans certains pays, peut accroître l’accessibilité et la détection précoce de ces maladies. Cependant, une mise en œuvre efficace nécessite des changements culturels et des campagnes d’éducation, comme on l’a constaté avec l’autodépistage du VPH.
De nombreuses technologies actuelles ne sont pas produites à des prix abordables ou en volume suffisant pour répondre à la demande. Par exemple, le coût élevé du vaccin anti-VPH est une charge pour de nombreux pays. Un recours accru aux Fonds renouvelables régionaux peut améliorer l’accès à des produits rentables. La participation de 42 pays au Fonds renouvelable pour l’accès aux vaccins permet d’économiser 50 % environ sur le prix des 13 vaccins systématiques les plus utilisés. Le renforcement des écosystèmes d’innovation et de production peut créer un système plus résilient et autosuffisant. La promotion de la concurrence, notamment via des productions locales et régionales, est essentielle pour surmonter les défis, tels que le coût élevé des vaccins anti-VPH. De plus, une utilisation élargie des outils existants tels que l’outil de suivi de la performance du Programme élargi de vaccination national peut améliorer la distribution des vaccins dans les zones mal desservies (12).
En 2022, les États Membres ont réaffirmé leur engagement à renforcer les systèmes réglementaires nationaux permettant de répondre aux demandes croissantes du marché et de riposter aux urgences sanitaires (13). Ces systèmes, ainsi que des initiatives transversales telles que la gestion intégrée de la chaîne d’approvisionnement et les achats groupés (via les Fonds renouvelables régionaux, par exemple), peuvent améliorer la disponibilité des technologies sanitaires essentielles et accélérer les efforts d’élimination des maladies dans toute la Région.
« Alors que nous progressons dans le relèvement après la pandémie, le moment est venu de donner à l’Initiative d'élimination un élan renouvelé plus fort et plus réfléchi, afin d’atteindre une cible établie pour les maladies transmissibles dès la création de l’Organisation, il y a 120 ans. »" Jarbas Barbosa da Silva Jr., Directeur de l'OPS
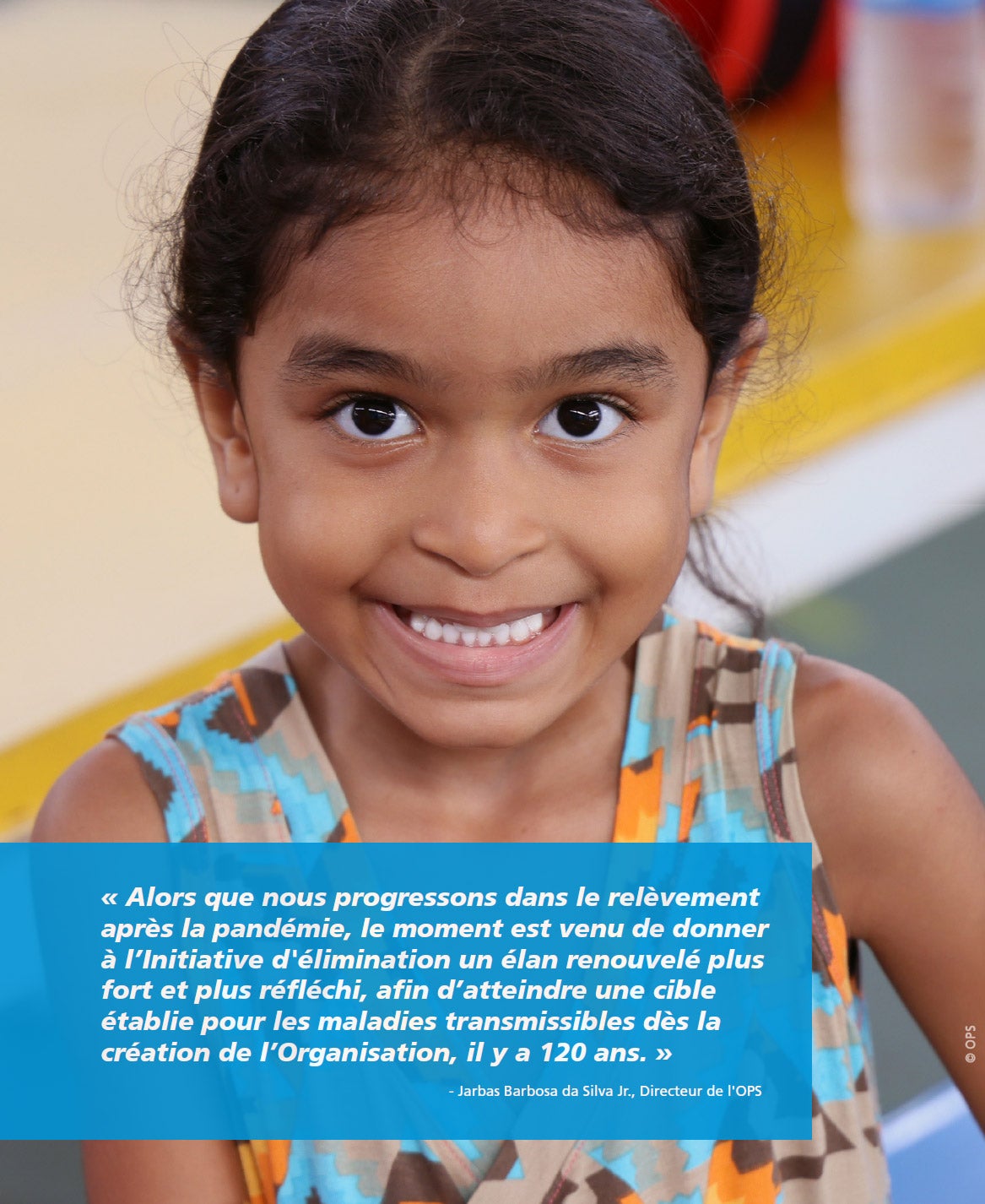
Approche : eau, assainissement et hygiène
Pourquoi est-ce important ?
Les programmes d’eau, d’assainissement et d’hygiène sont essentiels à la prévention et à la gestion des maladies transmissibles. L’accès à une eau dépourvue de risque sanitaire et à des services d’assainissement joue un rôle clé dans l’élimination des maladies infectieuses négligées, telles que les géohelminthiases, la schistosomiase, la fascioliase humaine et le trachome. Néanmoins, au-delà de ces maladies infectieuses négligées, l’eau, l’assainissement et l’hygiène sont essentiels pour éliminer toutes les maladies (14). Par exemple, des pratiques sûres concernant l’eau, l’assainissement et l’hygiène lors d’un accouchement peuvent contribuer à l’élimination de la transmission mère-enfant de certaines maladies. De plus, les personnes vivant avec le VIH sont plus susceptibles de souffrir de diarrhées, ce qui peut mettre leur vie en danger et pénaliser l'efficacité des antirétroviraux. L’amélioration de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène peut aussi réduire ces épisodes diarrhéiques (15).
Que fait-on actuellement ?
De nombreux pays mettent à jour leurs politiques et réglementations en matière d’eau, d’assainissement et d’hygiène avec l’assistance technique de l’OPS. Les stratégies dans ce domaine pour lutter contre les maladies transmissibles ciblent actuellement l’amélioration de la qualité de l’eau, le renforcement des infrastructures d’assainissement, la promotion des pratiques d’hygiène et la mise en œuvre de mesures efficaces de lutte antivectorielle. Bien que des progrès aient été réalisés, des défis persistent, en particulier dans les zones rurales et les zones urbaines à faible revenu. Par exemple, les impacts des changements climatiques (notamment l'évolution des tendances météorologiques et la fréquence accrue des catastrophes naturelles) compliquent les efforts visant à améliorer l’accès à l’eau, à l’assainissement et à l’hygiène, en particulier dans les communautés éloignées qui disposent d’infrastructures limitées. En outre, l’insuffisance historique des investissements et les inégalités sociales persistantes continuent d’entraver l’accès généralisé à ces services essentiels sur l’ensemble de la Région.
Comment les pays peuvent-ils accélérer les progrès ?
Sainte-Lucie avait autrefois des niveaux élevés de prévalence et de morbidité de la schistosomiase : après que l’île a eu assuré un accès généralisé à l’assainissement et à une eau dépourvue de risque sanitaire, la schistosomiase a pratiquement disparu (16). D’autres pays peuvent suivre son exemple en élargissant leurs programmes d’eau, d’assainissement et d’hygiène existants pour intégrer la prévention et la gestion des maladies infectieuses négligées, ainsi que d’autres maladies infectieuses à transmission vectorielle ou liées à l’eau (17). Cela peut être difficile, car les fonds alloués par les pays aux maladies négligées sont souvent limités. Pour accélérer la mise à disposition de services d’eau, d’assainissement et d’hygiène pour éliminer les maladies, il est donc nécessaire d’adopter des approches multidimensionnelles et créatives, des partenariats entre les gouvernements, le secteur privé et les organisations internationales, des financements accrus et une mobilisation des ressources, et des activités intégrées auxquelles participe du personnel national des secteurs de l’eau, de l’assainissement et de la santé, comme approuvé par la Stratégie mondiale sur l’eau, l’assainissement et l’hygiène pour lutter contre les maladies infectieuses négligées, 2021-2030 (18). Un récent cours virtuel sur l’eau, l’assainissement et l’hygiène, qui regroupait des participants de cinq pays, démontre le potentiel de tels efforts intégrés (19).
Consolider les systèmes stratégiques de surveillance sanitaire et d'information sur la santé (AXE D'INTERVENTION 2)
Approche : renforcer les systèmes de surveillance et d’information sur la santé
Pourquoi est-ce important ?
Les systèmes de surveillance qui permettent le suivi des maladies (notamment l’interopérabilité entre les systèmes et les plateformes, les capacités de partage des données, les technologies émergentes comme l’intelligence artificielle, la détection précoce des menaces pour la santé publique et le renforcement des capacités des agents de santé) peuvent garantir une administration efficace, ainsi qu’une collecte et une gestion précises et rapides des données, en particulier dans les zones mal desservies et les zones transfrontalières. Les systèmes d’information interconnectés permettent également d’évaluer l’efficacité réelle des interventions.
Que fait-on actuellement ?
En partenariat avec les Centres pour la prévention et le contrôle des maladies des États-Unis et avec certains pays, l’OPS appuie l’utilisation d’une plateforme de laboratoire unique, appelée test par microbilles multicibles, pour analyser les anticorps développés contre un éventail de 50 à 500 agents pathogènes différents dans un unique échantillon de sang. En surveillant plusieurs maladies qui se chevauchent dans certaines populations ou dans certaines zones géographiques, le test par microbilles multicibles permet de mieux comprendre la transmission, de suivre les impacts des interventions (la vaccination, par exemple), d’identifier les populations sensibles et de traiter plusieurs affections simultanément.
 De plus, l’Initiative d’élimination des maladies incite à inclure davantage les maladies transmissibles aux activités de surveillance existantes. Par exemple, la surveillance de la paralysie flasque aiguë a été un élément clé de la détermination des points chauds de transmission du poliovirus. D’autres efforts de surveillance innovants peuvent également être mis en œuvre, comme les efforts de surveillance génomique, qui ont été élargis pendant la pandémie de COVID-19 (20) et pourraient également avoir un impact sur l’Initiative d’élimination des maladies. Bien que le recours à cette surveillance varie considérablement d’un pays de la Région à l’autre, l’infrastructure et l’expertise développées pour la surveillance génomique de la COVID-19 fournissent des outils précieux pour détecter les agents pathogènes et les nouveaux variants, actualiser les formulations des vaccins et orienter les diagnostics, au-delà même de la simple surveillance du virus de la COVID-19. De plus, des efforts de surveillance communautaire sont déployés dans toute la Région. Par exemple, le système brésilien d’information sur la santé de la faune sauvage fait participer les communautés locales à la surveillance collaborative de la fièvre jaune potentiellement due à des primates non humains (21).
De plus, l’Initiative d’élimination des maladies incite à inclure davantage les maladies transmissibles aux activités de surveillance existantes. Par exemple, la surveillance de la paralysie flasque aiguë a été un élément clé de la détermination des points chauds de transmission du poliovirus. D’autres efforts de surveillance innovants peuvent également être mis en œuvre, comme les efforts de surveillance génomique, qui ont été élargis pendant la pandémie de COVID-19 (20) et pourraient également avoir un impact sur l’Initiative d’élimination des maladies. Bien que le recours à cette surveillance varie considérablement d’un pays de la Région à l’autre, l’infrastructure et l’expertise développées pour la surveillance génomique de la COVID-19 fournissent des outils précieux pour détecter les agents pathogènes et les nouveaux variants, actualiser les formulations des vaccins et orienter les diagnostics, au-delà même de la simple surveillance du virus de la COVID-19. De plus, des efforts de surveillance communautaire sont déployés dans toute la Région. Par exemple, le système brésilien d’information sur la santé de la faune sauvage fait participer les communautés locales à la surveillance collaborative de la fièvre jaune potentiellement due à des primates non humains (21).
Entre 2016 et 2023, l’OPS a réalisé une évaluation de la maturité des systèmes d’information pour la santé (connus sous le sigle anglais IS4H), la première du genre dans la Région. À l’aide de plus de 240 indicateurs normalisés, elle a évalué les systèmes nationaux d’information sanitaire sur une échelle de 1 à 5 et constaté que 42,8 % des pays se situent au niveau 1, soit « sensibilisation ». Ces pays commencent à adopter les IS4H, mais ont une capacité limitée à produire des données de haute qualité. Un tiers des pays, soit 34,7 %, ont atteint le niveau 2, soit « mise en application des meilleures pratiques ». Ceux-ci élaborent des systèmes et gèrent efficacement l’information sur la santé, mais sont confrontés à des défis tels que l’établissement incomplet d’indicateurs et l’insuffisance de partage des données. Un autre 18,4 % a atteint le niveau 3, soit « normalisation et amélioration continue », ce qui reflète les progrès des politiques et l’utilisation de données de haute qualité pour la prise de décisions. Seuls 4,1 % des pays se situent au niveau 4, soit « intégration et alignement », et possèdent des systèmes d’information hautement intégrés alignés sur les normes nationales et internationales. Aucun pays de la Région n’atteint le niveau 5. Un rapport complet sur l’évaluation régionale de la maturité des IS4H sera publié fin 2024.
Comment les pays peuvent-ils accélérer les progrès ?
Le regain d’intérêt de l’OPS pour les IS4H est essentiel à l’élimination des maladies transmissibles. Les pays doivent moderniser leurs systèmes de surveillance de la santé publique au sein de systèmes d’information interopérables et de plateformes de données ouvertes, afin de permettre une détection en temps réel et une réponse rapide aux flambées épidémiques. Il s'agit de passer du papier à des plates-formes électroniques pour la gestion des données, les outils de suivi et les dossiers médicaux électroniques, sur la base des normes internationales. Les pays doivent également cibler l’interopérabilité nationale et transfrontalière des systèmes et des plateformes d’information pour la maîtrise et la prévention des maladies, ainsi que pour le partage de données et d’informations critiques. La surveillance intégrée contribuera à accélérer les progrès vers l’élimination. Dans de nombreux pays, une surveillance propre à chaque maladie continue d’être la norme, ce qui entraîne des inefficiences et une redondance des efforts, en particulier au premier niveau de soins. Il est urgent d’accélérer la mise en place et l’élargissement de plateformes innovantes qui permettent de surveiller de multiples maladies, afin d’améliorer l’efficience et de veiller à ce que les services de santé répondent aux contextes et aux besoins propres aux populations.
Il est nécessaire d’améliorer la disponibilité et l’exactitude des données pour quantifier l’ampleur de la maladie et les besoins d’approvisionnement en matière de santé, en veillant à ce que les ressources soient correctement allouées et à ce que les chaînes d’approvisionnement soient alignées sur les besoins de l’initiative. En outre, les plateformes de données ouvertes et les systèmes d’information doivent inclure un ensemble normalisé de stratificateurs d’équité, et les formulaires de collecte de données peuvent être améliorés pour inclure des informations relatives à une affection sous-jacente à l'origine du décès ou de la maladie d’un patient. L’ajout de telles informations, en particulier aux registres numériques, peut permettre aux pays de pleinement comprendre l’impact et l’ampleur des maladies transmissibles.
Approche : des données pour la prise de décision à tous les niveaux
Pourquoi est-ce important ?
Des plateformes et des systèmes de données ouverts et fiables sont essentiels à l’élimination des maladies transmissibles. Ils permettent des actions en temps réel, des interventions ciblées, une allocation efficiente des ressources et la formulation de politiques fondées sur des données probantes. Les données facilitent le suivi des progrès, la prise de décision et la collaboration transfrontalière et intersectorielle, ce qui permet d’élaborer des stratégies d’élimination plus efficaces et plus durables.
Que fait-on actuellement ?
L’OPS et les États Membres utilisent les données épidémiologiques pour déterminer les tendances, évaluer l’efficacité réelle des interventions et orienter la prise de décisions stratégiques. Cette approche fondée sur les données permet de déployer des efforts plus ciblés et plus efficients en matière de lutte contre les maladies, des campagnes de vaccination à la lutte antivectorielle, tout en facilitant la collaboration transfrontalière et en répondant aux préoccupations relatives à l’équité en santé. Les pays ont amélioré la gestion de leurs données sanitaires grâce à des systèmes de notification en ligne, au renforcement des capacités d’analyse de données, à l'amélioration des outils de vérification et à des tableaux de bord et des référentiels nationaux. On peut citer à titre d’exemple la mise en place de registres électroniques de vaccination dans 19 pays de la Région. Ces systèmes ont considérablement amélioré la capacité à suivre les taux de vaccination, à déterminer les lacunes de couverture vaccinale et à localiser les enfants n’ayant reçu aucune dose. En outre, l’OPS s’est efforcée de renforcer la surveillance des maladies à prévention vaccinale en encourageant l’utilisation de plateformes en ligne ouvertes. Ces progrès ont favorisé la prise de décisions fondées sur les données, ce qui a conduit à des stratégies de santé publique plus efficaces et à de meilleurs résultats en matière de santé dans toute la Région.
 Les Fonds renouvelables régionaux ont également lancé en 2023 le portail des États Membres, qui permet aux pays de soumettre chaque année l'estimation de leurs besoins et de planifier leurs demandes de manière groupée, ainsi que de fournir aux décideurs des informations en temps réel. Le portail affiche également des rapports financiers et d’autres données de santé publique. C’est un outil essentiel à l’exécution de l’activité principale des Fonds, qui est d’analyser et de consolider les demandes afin d’obtenir de meilleures conditions pour les pays et territoires relativement aux technologies de santé utilisées pour traiter, prévenir ou diagnostiquer les maladies ciblées pour l’élimination. Cette technologie facilite la collaboration entre l’OPS, les spécialistes des maladies, les organismes de réglementation et les fournisseurs, afin d’appuyer les efforts d’élimination des maladies. De plus, l’OPS a mis au point un tableau de bord numérique pour aider les décideurs à parcourir les portefeuilles des Fonds relatifs à des initiatives essentielles, comme l’Initiative d’élimination des maladies.
Les Fonds renouvelables régionaux ont également lancé en 2023 le portail des États Membres, qui permet aux pays de soumettre chaque année l'estimation de leurs besoins et de planifier leurs demandes de manière groupée, ainsi que de fournir aux décideurs des informations en temps réel. Le portail affiche également des rapports financiers et d’autres données de santé publique. C’est un outil essentiel à l’exécution de l’activité principale des Fonds, qui est d’analyser et de consolider les demandes afin d’obtenir de meilleures conditions pour les pays et territoires relativement aux technologies de santé utilisées pour traiter, prévenir ou diagnostiquer les maladies ciblées pour l’élimination. Cette technologie facilite la collaboration entre l’OPS, les spécialistes des maladies, les organismes de réglementation et les fournisseurs, afin d’appuyer les efforts d’élimination des maladies. De plus, l’OPS a mis au point un tableau de bord numérique pour aider les décideurs à parcourir les portefeuilles des Fonds relatifs à des initiatives essentielles, comme l’Initiative d’élimination des maladies.
Les efforts de gouvernance des données sur toute la Région des Amériques, fondés sur l’évaluation de la maturité des IS4H, ont mis en évidence d’importants défis dans le secteur de la santé. Un manque d’interopérabilité entre les systèmes de santé est courant, ce qui entrave l’efficience du partage de données et de la coordination. De nombreux pays sont également confrontés à l’absence de politiques d’adoption des normes internationales, ce qui entraîne une gestion fragmentée des données. En outre, il existe différents niveaux de transformation numérique, certains pays progressant tandis que d’autres sont à la traîne. Enfin, la Région affiche une faible capacité en matière d’intelligence artificielle et de techniques de science des données pour gérer les données de santé, ce qui limite l’innovation et l’efficience. Ces lacunes soulignent la nécessité de renforcer les politiques, les investissements et les capacités en matière de santé numérique.
Comment les pays peuvent-ils accélérer les progrès ?
Bien que les ensembles nationaux de données agrégées aient leur importance, il est nécessaire de disposer de davantage de données ventilées à des niveaux infranationaux pour prendre des décisions relatives aux efforts vis-à-vis des maladies transmissibles. Les États Membres et les partenaires peuvent également développer des outils qui présentent les données plus efficacement aux décideurs, aux responsables de la mise en œuvre des programmes et aux agents de santé. L’approche globale doit être axée sur le renforcement de la collecte de données en temps réel et des plateformes de données ouvertes qui surveillent les maladies ciblées pour l'élimination. Cela nécessite d’intégrer des données provenant de sources locale, régionale et nationale, afin d’obtenir une vue exhaustive des menaces sanitaires. Il est également essentiel d’aligner les systèmes de surveillance sur les normes internationales et de promouvoir l’utilisation de plateformes interopérables pour un partage efficient des données et des réponses en temps opportun. Le renforcement des capacités en science des données est également crucial, car il permet aux agents de santé d’utiliser les données pour la détection précoce, pour l’analyse des risques et pour la prise de décisions stratégiques. Enfin, promouvoir les partenariats régionaux ainsi que l’interopérabilité et la collaboration transfrontalières permettra d’harmoniser les efforts de surveillance, en permettant aux pays de partager des données en temps réel, mais aussi d’échanger les meilleures pratiques et de mobiliser des ressources. Cette intégration favorise la prise de décisions éclairées, l’allocation efficiente des ressources et l’amélioration des soins aux patients.
Les États Membres doivent également relever les défis de la mise en œuvre de systèmes de données en temps réel, notamment le manque d’infrastructures numériques et les disparités d’accès à la technologie. Les systèmes de santé numériques peuvent fournir des outils utiles pour collecter les données en temps opportun, notamment au niveau infranational et pour les communautés les plus marginalisées et les plus mal desservies.
Approche : lutter contre la résistance aux antimicrobiens
Pourquoi est-ce important ?
La résistance aux antimicrobiens menace l’efficacité de la prévention et du traitement d’une série de maladies infectieuses dues à des bactéries, des parasites, des virus ou des champignons. Par exemple, les taux de tuberculose multirésistante (TB-MR) et de tuberculose résistante à la rifampicine (TB-RR) augmentent dans la Région : en 2022, on estimait à 11 600 le nombre de cas de tuberculose TB-MR/TB-RR et à 5428 le nombre de cas diagnostiqués, soit une augmentation de 12 % par rapport à 2021 (22). Le Plan d’action sur la résistance aux antimicrobiens de l’OPS aide les États Membres à prendre les mesures nécessaires pour prévenir et traiter les maladies transmissibles à l'aide de médicaments et de technologies sûrs, efficaces, abordables et de qualité garantie (23).
Que fait-on actuellement ?
Les pays progressent régulièrement dans le renforcement de leurs capacités de surveillance et de confinement de la résistance aux antimicrobiens. À l’heure actuelle, 20 pays participent au Réseau latino-américain de surveillance de la résistance aux antimicrobiens (ReLAVRA). Ce réseau organise régulièrement des réunions avec ses membres pour partager l’information sur la surveillance de la résistance dans les pays. Cela permet aux États Membres d’obtenir des données systématiques pour surveiller l’ampleur et la tendance de la résistance aux antimicrobiens. Le ReLAVRA travaille également à l’introduction et à la mise à l’échelle de nouvelles technologies de suivi de cette résistance (24). Ces efforts s’inscrivent dans le droit fil de l’Initiative d’élimination des maladies, en particulier des efforts que cette initiative déploie pour renforcer les systèmes de surveillance sanitaire et les systèmes d’information sur la santé.
Comment les pays peuvent-ils accélérer les progrès ?
Pour accélérer les progrès en matière de surveillance de la résistance aux antimicrobiens en vue de prévenir les maladies transmissibles, les programmes d’élimination doivent cibler l’amélioration de la collecte et du partage des données via des plateformes numériques normalisées, la mise en œuvre de techniques de laboratoire avancées comme les tests rapides et le recours à l’approche « Une seule santé » pour intégrer la surveillance dans les secteurs humain, animal et environnemental. Les programmes peuvent également tirer parti de l’intelligence artificielle pour l’analyse des données et la modélisation prédictive, tout en renforçant la capacité des équipes de données et de surveillance à détecter les menaces de résistance aux antimicrobiens, et à y riposter.
Intervenir sur les déterminants sociaux et environnementaux de la santé (AXE D'INTERVENTION 3)
Approche : utiliser les outils disponibles pour mesurer et améliorer l’équité
Pourquoi est-ce important ?
Les déterminants sociaux de la santé englobent les conditions non médicales qui affectent les résultats en matière de santé. Il s’agit du contexte dans lequel les personnes naissent, grandissent, travaillent, vivent et vieillissent, ainsi que des facteurs élargis qui conditionnent leur vie quotidienne, notamment les politiques économiques, les normes sociales et les systèmes politiques. Les travaux de recherche indiquent que les déterminants sociaux de la santé comptent pour 30 à 55 % des effets sur la santé (25). En s’attaquant à l’ensemble complexe des facteurs qui influencent les résultats en santé, les programmes de lutte contre les maladies transmissibles peuvent mettre en œuvre des approches plus efficaces, plus équitables et plus durables.
Que fait-on actuellement ?
Les outils existants sont actuellement utilisés par les responsables de mise en œuvre, les concepteurs et les chercheurs des États Membres de l’OPS pour mesurer les iniquités dans le cadre des programmes de lutte contre les maladies transmissibles. Il s’agit notamment de l’outil d’évaluation de l’équité en santé de l’OMS (26), de l’outil Innov8 et du site Web de l’OPS permettant de suivre les progrès accomplis vers les objectifs de développement durable (en particulier la section analysant les progrès et les iniquités liés à l’ODD3, tant au niveau régional que national) (27). Certaines analyses fondées sur l’équité ont déjà été suivies d’interventions ajustées. Par exemple, la reconnaissance du risque élevé de tuberculose dans les prisons a conduit à une intensification des efforts de dépistage, de diagnostic et de traitement en milieu carcéral (28).
Comment les pays peuvent-ils accélérer les progrès ?
L’introduction de listes de vérification plus simples et plus efficientes pourrait accroître l’application des outils d’équité dans tous les pays et dans tous les domaines de la santé. Une utilisation cohérente et plus élargie de ces ressources aiderait les programmes à cerner les mécanismes menant à la vulnérabilité, tout en s’éloignant des approches universelles. De la même manière, l’accès à davantage de données communautaires, et leur utilisation, aideraient l’OPS et les États Membres à mettre en place des stratégies d’élimination des maladies ciblées et ajustées pour s’attaquer aux obstacles systémiques. Par exemple, les personnes vivant dans des zones reculées de l’Amazonie peuvent présenter plusieurs problèmes de santé à résoudre en une seule consultation, et donc nécessiter des services entièrement intégrés qui abordent en une consultation unique le dépistage, le diagnostic, le traitement, ainsi que d’autres services. Un autre exemple est celui des parents sans conjoint, qui n’ont peut-être pas accès aux cliniques de vaccination en semaine. Les programmes pourraient s’adapter et atteindre ces groupes plus efficacement en offrant des consultations dans les centres commerciaux ou en ajustant les heures d’ouverture des centres de consultations. En s’adaptant aux besoins et aux situations propres aux groupes marginalisés, des stratégies ajustées comme celles-ci peuvent améliorer l’accès de certains groupes à divers services de santé.
Approche : adopter une perspective interculturelle
Pourquoi est-ce important ?
Adopter une perspective interculturelle permet de garantir que les interventions en santé sont appropriées sur le plan culturel, qu’elles s’attaquent aux disparités et qu’elles renforcent la confiance des communautés marginalisées. En tenant compte des diverses croyances culturelles et pratiques traditionnelles et des styles de communication, les efforts d’élimination des maladies peuvent être plus efficaces, équitables et pérennes sur l’ensemble d’une Région diversifiée.
Que fait-on actuellement ?
Les États Membres de l’OPS ont approuvé à l’unanimité la Politique en matière d’ethnicité et de santé en 2017 et la Stratégie et plan d’action sur l’ethnicité et la santé 2019-2025 en 2019. Celles-ci s’appuient sur des initiatives antérieures telles que l’adoption, en 2006, de la résolution sur la santé des populations autochtones des Amériques (29). En 2023, l’OPS a appuyé une résolution de l’Assemblée mondiale de la Santé sur la santé des populations autochtones (30). Ces politiques favorisent une approche interculturelle et participative de la santé, qui vise à intégrer les perspectives autochtones et à éliminer les disparités en matière de santé affectant ces communautés dans la Région des Amériques.
 De nombreux pays de la Région ont également mis en place des politiques et des programmes sanitaires interculturels. Par exemple, l’État plurinational de Bolivie a intégré la médecine traditionnelle à son système national de santé. Sa politique nationale de santé familiale communautaire interculturelle (SAFCI) intègre la médecine traditionnelle au programme de santé publique, avalisant ainsi les pratiques de guérison autochtones à côté de celles de la médecine moderne. L’État bolivien a également intégré les sages-femmes traditionnelles au système de santé, afin de promouvoir le dialogue interculturel et d’obtenir de meilleurs résultats en matière de santé (31).
De nombreux pays de la Région ont également mis en place des politiques et des programmes sanitaires interculturels. Par exemple, l’État plurinational de Bolivie a intégré la médecine traditionnelle à son système national de santé. Sa politique nationale de santé familiale communautaire interculturelle (SAFCI) intègre la médecine traditionnelle au programme de santé publique, avalisant ainsi les pratiques de guérison autochtones à côté de celles de la médecine moderne. L’État bolivien a également intégré les sages-femmes traditionnelles au système de santé, afin de promouvoir le dialogue interculturel et d’obtenir de meilleurs résultats en matière de santé (31).
Comment les pays peuvent-ils accélérer les progrès ?
Pour inclure à l’Initiative d’élimination des maladies les populations en situation de vulnérabilité, les stratégies nationales doivent intégrer et élargir les approches interculturelles. Des études menées en Colombie sur les modèles de soins de santé participatifs dans les communautés autochtones soulignent l’importance et l’efficacité de la consultation communautaire relativement aux vaccins, aux traitements et aux efforts de lutte contre les maladies (32, 33). La campagne d’action vaccinale de l’OPS dans l’État plurinational de Bolivie, qui cible les faibles taux de vaccination anti-COVID-19, illustre également cette approche. L’initiative s’est attaquée aux problèmes de la réticence à la vaccination et de l'accès aux vaccins dans les communautés autochtones éloignées, en utilisant diverses stratégies ajustées sur le plan culturel, comme le dialogue communautaire, l’organisation d’ateliers, la diffusion d’annonces radiophoniques et l’organisation de spectacles au sein des communautés. Il en a résulté une augmentation des taux d’acceptation des vaccins pour les enfants, ce qui démontre l’importance de la sensibilisation culturelle et d’une communication diversifiée dans l’amélioration des résultats en matière de santé publique (34).
L’engagement communautaire peut être renforcé par la création d’environnements accueillants, qui comportent une signalisation inclusive et des services d’interprétation. Ils peuvent également intégrer des pratiques traditionnelles de guérison et élaborer du matériel d’éducation à la santé adapté sur le plan culturel. Des rencontres régulières au niveau municipal entre les prestataires de santé et les guérisseurs traditionnels peuvent favoriser le dialogue et permettre d'adapter les services aux besoins locaux, ce qui améliore finalement la portée et l’efficacité réelle de l’initiative.
Approche : Une seule santé
Pourquoi est-ce important ?
L’approche « Une seule santé » est une approche intégrée qui optimise la santé des personnes, des animaux et des écosystèmes, et peut faciliter l’élimination des maladies au niveau local. Au cours de la pandémie de COVID-19, les laboratoires de maladies animales ont été réaffectés à la réalisation de tests chez l’homme et ont démontré leur potentiel en la matière. De même, les services de santé humaine peuvent gérer les fournitures de santé animale, les vaccins antirabiques canins par exemple. Cette intégration renforce la capacité locale en matière de services de santé animale, humaine et environnementale, ce qui appuie les objectifs de l’Initiative d’élimination des maladies.
Que fait-on actuellement ?
 En 2021, les États Membres de l’OPS ont adopté une politique « Une seule santé » pour relever les défis sanitaires actuels et futurs de la Région (35). En outre, l’Initiative d’élimination des maladies est alignée sur les recommandations du Plan d’action conjoint « Une seule santé » (2022-2026) relatives aux zoonoses, aux maladies tropicales négligées et aux maladies à transmission vectorielle (36). Dans la pratique, l’approche « Une seule santé » suppose que les secteurs de la santé humaine et de la santé animale collaborent aux niveaux national et communautaire pour les activités de surveillance, de déclaration croisée et de prévention qui affectent directement la santé humaine, telles que la vermifugation des animaux pour prévenir des maladies humaines comme l’échinococcose kystique/hydatidose et la fascioliase.
En 2021, les États Membres de l’OPS ont adopté une politique « Une seule santé » pour relever les défis sanitaires actuels et futurs de la Région (35). En outre, l’Initiative d’élimination des maladies est alignée sur les recommandations du Plan d’action conjoint « Une seule santé » (2022-2026) relatives aux zoonoses, aux maladies tropicales négligées et aux maladies à transmission vectorielle (36). Dans la pratique, l’approche « Une seule santé » suppose que les secteurs de la santé humaine et de la santé animale collaborent aux niveaux national et communautaire pour les activités de surveillance, de déclaration croisée et de prévention qui affectent directement la santé humaine, telles que la vermifugation des animaux pour prévenir des maladies humaines comme l’échinococcose kystique/hydatidose et la fascioliase.
Plusieurs pays disposent de stratégies nationales « Une seule santé », notamment l’État plurinational de Bolivie et le Guyana. D’autres pays utilisent l’approche « Une seule santé » pour riposter à des maladies données. Par exemple, les efforts coordonnés des services vétérinaires, environnementaux et de santé publique dans plusieurs pays, dont le Guatemala, le Honduras et le Nicaragua, ont permis de réduire considérablement le nombre de cas de rage grâce à des campagnes de vaccination canine et à l’éducation communautaire. De la même manière, pour lutter contre la maladie de Chagas, des programmes de collaboration dans les pays touchés, notamment El Salvador et le Honduras, ciblent l’amélioration des conditions de logement, la lutte antivectorielle et l’éducation à la santé.
Comment les pays peuvent-ils accélérer les progrès ?
Les principales stratégies pour accélérer l’approche « Une seule santé » comprennent l’amélioration des systèmes de surveillance, l’augmentation des financements, l’accent mis sur la prévention, la lutte contre la résistance aux antimicrobiens et le renforcement des politiques. Le succès dépend de la collaboration intersectorielle, de la coopération transfrontalière et des engagements à long terme quant à ces efforts intégrés. De plus, lors de la mise en œuvre d’une approche « Une seule santé » dans les initiatives d’élimination des maladies, les programmes doivent tenir compte des aspects culturels affectant les pratiques traditionnelles de santé animale, de production et de salubrité des aliments dans les communautés locales.Key strategies for accelerating the One Health approach include improving surveillance systems, increasing funding, focusing on prevention, addressing antimicrobial resistance, and strengthening policies. Success hinges on cross-sector collaboration, cross-border cooperation, and long-term commitments to these integrated efforts. Also, when implementing a One Health approach in disease elimination initiatives, programs must consider cultural aspects affecting traditional animal health, production, and food safety practices within local communities.
Approche : lutter contre les changements climatiques
Pourquoi est-ce important ?
Les changements climatiques ont un impact énorme sur les maladies transmissibles. La hausse des températures et l’évolution des modèles de précipitations élargissent la gamme de vecteurs, les moustiques par exemple, ce qui permet l'introduction de maladies dans de nouvelles zones ou l'intensification de la transmission dans les régions d'endémie. Par exemple, des estimations récentes prévoient que le nombre supplémentaire de personnes exposées au risque de paludisme en raison des changements climatiques en Amérique du Sud passera de 25 millions en 2020 à 50 millions d’ici à 2080 (37). Les événements d’origine climatique tels que les sécheresses et les inondations peuvent entraîner des migrations, ce qui expose les populations à de nouveaux agents pathogènes et à de mauvaises conditions de vie, comme on l’a constaté lors de la récente flambée épidémique de choléra en Haïti. Parmi les autres facteurs environnementaux influençant la propagation des maladies, citons le manque d’accès à l’eau potable, la mauvaise qualité de l’air, la déforestation et les systèmes alimentaires non favorables à la santé, tous facteurs qui interagissent avec les déterminants sociaux et économiques, ce qui rend les défis encore plus complexes.
Que fait-on actuellement ?
L’OPS et les États Membres s’attaquent activement à l’impact des changements climatiques sur la santé par le biais du programme sur les changements climatiques et la santé, qui aide les pays à évaluer les vulnérabilités en matière de santé, à élaborer des plans d’adaptation et à renforcer la résilience au climat des systèmes de santé. En outre, l’OPS s’efforce d’améliorer les systèmes de surveillance des maladies tenant compte du climat et les mécanismes d’alerte précoce, afin de mieux prévoir les flambées épidémiques de maladies sensibles au climat en vue d’y riposter. L’OPS et les États Membres encouragent l’inclusion de préoccupations sanitaires aux politiques nationales de lutte contre les changements climatiques, ainsi qu’un financement dédié à la lutte contre ces changements pour les projets liés à la santé.
Comment les pays peuvent-ils accélérer les progrès ?
La lutte contre les changements climatiques et les déterminants de la santé environnementale est essentielle pour une maîtrise durable des maladies et elle s’aligne sur l’approche « Une seule santé ». Les principales stratégies de lutte contre les changements climatiques qui concernent l’élimination des maladies comprennent le renforcement de l’engagement politique, l’amélioration de la collaboration intersectorielle, l’augmentation du financement des initiatives en faveur de la santé et du climat et le renforcement des capacités locales. En mettant en œuvre collectivement ces stratégies, les pays de la Région des Amériques peuvent créer des conditions plus favorables à l’élimination, améliorer la résilience des systèmes de santé et mieux protéger les personnes vivant dans des situations de vulnérabilité.
Renforcer la gouvernance, la gestion stratégique et le financement (AXE D'INTERVENTION 4)
Approche : coordination intergouvernementale
Pourquoi est-ce important ?
L’Initiative d’élimination des maladies exige une coordination efficace entre les diverses institutions gouvernementales et les ministères, notamment ceux de la Santé, des Finances, de l’Éducation, de l’Environnement, de l’Agriculture, des Affaires étrangères, des Sciences et des technologies, et du Commerce. Au sein du secteur de la santé, de multiples groupes doivent collaborer, qui vont de la santé de la mère et de l'enfant au renforcement des systèmes de santé et à la surveillance. Cet effort coordonné facilite le partage des ressources, l’harmonisation de la surveillance, l’alignement des politiques et la cohérence d'une stratégie en vue de maximiser l’impact de l’initiative. L’élargissement au-delà du secteur de la santé et l’intégration à d’autres interventions favorisent l’appropriation conjointe de l’initiative et améliorent sa pérennité financière à long terme.
Que fait-on actuellement ?
L’Initiative d’élimination des maladies applique l’approche de la santé dans toutes les politiques, soit une approche collaborative d’élaboration des politiques qui tient compte des répercussions sur la santé de manière systématisée et dans tous les secteurs. En outre, certains pays (Brésil, El Salvador et Honduras) ont établi des plans nationaux intergouvernementaux pour l’élimination des maladies.
En 2023, le Brésil a établi le Comité interministériel pour l’élimination de la tuberculose et d’autres maladies à déterminisme social (CIEDDS). Associant 14 ministères sous la coordination du ministère de la Santé, ce comité a l’objectif de promouvoir des actions intersectorielles qui visent à éliminer les maladies fortement influencées par les déterminants sociaux, en particulier celles qui touchent les personnes vivant en situation de vulnérabilité. Le CIEDDS élabore un programme national pour l’élimination des maladies socialement déterminées, en ciblant de nombreuses affections visées par l’initiative, telles que la transmission mère-enfant du VIH, de la syphilis, de la maladie de Chagas et de l’hépatite B, ainsi que la tuberculose, la lèpre et le paludisme. Cette initiative est le fruit d'un effort gouvernemental coordonné pour s’attaquer aux facteurs tant médicaux que sociaux qui contribuent à ces problèmes de santé au Brésil (38).
De la même manière, en février 2024, El Salvador a lancé un plan national de prévention, de maîtrise et d’élimination des maladies tropicales, et créé une commission nationale intersectorielle pour mettre en œuvre ce plan. Élaboré selon l’approche « Une seule santé », le plan vise à accélérer les efforts relatifs à 11 maladies, dont certaines sont visées par l’initiative, telles que la maladie de Chagas, les géohelminthiases, le paludisme, la rage humaine transmise par le chien et la lèpre. La commission comprend des représentants du gouvernement, du monde universitaire et de l’OPS, ce qui permet de garantir des soins complets de santé humaine, de santé animale et de santé environnementale (39).
Par ailleurs, en juillet 2024, le ministère de la Santé du Honduras a mis en place, avec le soutien de l’OPS, un comité intersectoriel national qui cible l’élimination des maladies. Le comité a réexaminé les succès passés du Honduras en matière d’élimination des maladies et s’est concentré sur les maladies ayant un potentiel d’élimination, notamment le paludisme, la rage humaine transmise par le chien, la lèpre, la syphilis congénitale, la maladie de Chagas congénitale et le cancer du col de l’utérus, en esquissant les étapes futures pour accélérer les efforts nationaux visant à éliminer ces maladies et à améliorer la collecte de données dans le pays (40).
Comment les pays peuvent-ils accélérer les progrès ?
La création de groupes directeurs ou d’équipes spéciales de haut niveau incluant des représentants de multiples parties prenantes, ou la participation à de tels groupes ou à de telles équipes, renforcera la collaboration intergouvernementale pour l’élimination des maladies. Les enseignements tirés des pays qui ont réussi à mettre en place des groupes de travail intergouvernementaux pour l’élimination de plusieurs maladies peuvent permettre d’orienter des initiatives semblables. L’intégration des objectifs d’élimination aux plans nationaux de santé renforcera la pérennité et garantira les engagements politiques et financiers.
Le renforcement des actions menées par les gouverneurs et les maires au niveau infranational améliorera l’administration stratégique et le leadership, en répondant aux besoins spécifiques des communautés touchées par les maladies transmissibles via une approche intersectorielle. Tirer parti des stratégies en cours, comme le mouvement des municipalités saines, offre la possibilité d'accélérer les progrès vers les cibles d’élimination. En outre, la coordination entre les pays des initiatives de santé transfrontalières renforce encore un peu plus les efforts déployés pour atteindre ces objectifs.
Pour garantir la pérennité du soutien financier, les pays doivent accroître le financement national de l’élimination des maladies en réaffectant les budgets nationaux de la santé et en obtenant des fonds supplémentaires issus des programmes nationaux de développement. Des mécanismes de financement novateurs peuvent aider à combler les déficits de financement et à maintenir la dynamique.
Approche : partenariats public-privé
Pourquoi est-ce important ?
 Les partenariats entre secteurs public et privé peuvent contribuer à fournir des ressources essentielles, à stimuler l'innovation et à renforcer les capacités locales. Ces partenariats permettent aux populations vulnérables d’avoir accès à des interventions de santé économiquement abordables, favorisent la pérennité à long terme et encouragent la collaboration multisectorielle. De plus, le rôle du secteur privé en matière de gestion de la chaîne d’approvisionnement, de technologies sanitaires innovantes, de programmes de santé en milieu de travail et d’engagement communautaire élargit la portée et l’efficacité réelle des stratégies d’élimination des maladies, tout en pouvant contribuer à la lutte contre les iniquités. En tirant parti des forces des secteurs public et privé, les partenariats public-privé permettent aux pays de mettre en œuvre des solutions globales et intégrées, en obtenant les engagements politiques et financiers nécessaires à un impact durable sur la santé publique dans toute la Région des Amériques.
Les partenariats entre secteurs public et privé peuvent contribuer à fournir des ressources essentielles, à stimuler l'innovation et à renforcer les capacités locales. Ces partenariats permettent aux populations vulnérables d’avoir accès à des interventions de santé économiquement abordables, favorisent la pérennité à long terme et encouragent la collaboration multisectorielle. De plus, le rôle du secteur privé en matière de gestion de la chaîne d’approvisionnement, de technologies sanitaires innovantes, de programmes de santé en milieu de travail et d’engagement communautaire élargit la portée et l’efficacité réelle des stratégies d’élimination des maladies, tout en pouvant contribuer à la lutte contre les iniquités. En tirant parti des forces des secteurs public et privé, les partenariats public-privé permettent aux pays de mettre en œuvre des solutions globales et intégrées, en obtenant les engagements politiques et financiers nécessaires à un impact durable sur la santé publique dans toute la Région des Amériques.
Que fait-on actuellement ?
En matière de participation des partenaires, l’OPS adopte une approche souple, afin de pouvoir tirer parti des meilleures expertises, des données les plus probantes et des informations disponibles de la meilleure qualité. Le Programme d’élimination de l’onchocercose dans les Amériques, qui compte parmi ses partenaires des gouvernements nationaux, l’OPS et d’autres organismes de santé, des établissements universitaires, des fondations publiques et privées, ainsi que la société pharmaceutique Merck & Co, Inc. est un exemple de partenariat public-privé efficace. Grâce à l’éducation à la santé et à l’administration massive d’un médicament, l’ivermectine, le programme a réussi à éliminer la transmission de cette maladie dans 11 des 13 zones d’endémie. En raison du succès de ce programme, 94 % des personnes qui nécessitaient à l’origine un traitement n’en ont plus besoin, et quatre des six pays participants (Colombie, Équateur, Guatemala et Mexique) sont maintenant exempts de cette maladie (41). Un autre exemple est celui des recommandations adoptées lors de la 17e Réunion ministérielle interaméricaine sur la santé et l’agriculture (2016), qui ont souligné l’importance de la collaboration intersectorielle entre les secteurs de la santé, de l’agriculture et de l’environnement pour lutter contre les zoonoses et la résistance aux antimicrobiens, tout en garantissant la sécurité sanitaire des aliments (42). En outre, le département de l’OPS Innovation et accès aux médicaments et technologies sanitaires (IMT) et les Fonds renouvelables régionaux s’efforcent d’élargir les capacités de fabrication des vaccins et d’autres technologies de la santé dans la Région.
Comment les pays peuvent-ils accélérer les progrès ?
Des données probantes démontrent que les partenariats public-privé peuvent contribuer à faciliter l’accès aux services de soins de santé primaires, notamment dans les zones reculées, qui sont essentiels dans le cadre des efforts d’élimination des maladies. L’OPS et les États Membres peuvent considérer d'autres partenariats et doivent envisager des plans et des politiques pérennes avec les parties prenantes privées, tout en tenant soigneusement compte des contextes et des besoins locaux (43).
 © OPS
© OPS
Approche : participation de la société civile
Pourquoi est-ce important ?
La société civile éclaire les initiatives en matière de santé par ses connaissances au niveau local, ce qui améliore l’efficacité et l'adéquation culturelle des interventions. Cette participation peut être plus avantageuse qu’une approche descendante et elle permet d’obtenir de meilleurs résultats à long terme en matière de santé. Les communautés locales peuvent aider à planifier et à mettre plus efficacement en œuvre les programmes dans leurs contextes respectifs. Le renforcement des capacités des groupes de la société civile pour consolider leur rôle dans le cadre des efforts d’élimination des maladies peut contribuer à accroître leur sentiment d’appartenance et leur capacité à participer efficacement, ce qui peut conduire à des interventions plus durables et plus efficaces.
Que fait-on actuellement ?
Le cadre révisé des fonctions essentielles de santé publique (FESP) contribue à renforcer la participation multisectorielle et le rôle de la société civile dans la prise de décisions en matière de santé. Depuis son lancement en 2020, plusieurs pays de la Région ont mis en œuvre les FESP. Par exemple, plusieurs pays des Caraïbes, dont Saint-Kitts-et-Nevis et Saint-Vincent-et-les Grenadines, ont mené à bien des évaluations des FESP et ont intégré des sections sur les FESP à leurs politiques stratégiques nationales de santé.
 L’OPS a également appuyé et encouragé la participation sociale et le travail intersectoriel à tous les niveaux de la prise de décision ; par exemple, de concert avec l’OMS, l’OPS a organisé un réseau sur le travail intersectoriel et la participation sociale pour l’équité en santé dans la Région des Amériques. Un autre exemple est le groupe de coopération technique horizontale, créé en 1996 par les directeurs des programme nationaux de lutte contre le sida des pays d’Amérique latine. Au cours des dernières décennies, il a regroupé des réseaux régionaux et infrarégionaux de la société civile qui représentent les personnes vivant avec le VIH et les populations clés les plus touchées par cette infection. Ces réseaux participent à des sessions collaboratives virtuelles de renforcement des capacités et de plaidoyer, ainsi qu’à des réunions régulières en présentiel pour le partage de techniques et le dialogue politique.
L’OPS a également appuyé et encouragé la participation sociale et le travail intersectoriel à tous les niveaux de la prise de décision ; par exemple, de concert avec l’OMS, l’OPS a organisé un réseau sur le travail intersectoriel et la participation sociale pour l’équité en santé dans la Région des Amériques. Un autre exemple est le groupe de coopération technique horizontale, créé en 1996 par les directeurs des programme nationaux de lutte contre le sida des pays d’Amérique latine. Au cours des dernières décennies, il a regroupé des réseaux régionaux et infrarégionaux de la société civile qui représentent les personnes vivant avec le VIH et les populations clés les plus touchées par cette infection. Ces réseaux participent à des sessions collaboratives virtuelles de renforcement des capacités et de plaidoyer, ainsi qu’à des réunions régulières en présentiel pour le partage de techniques et le dialogue politique.
Établie en 2008, la politique SAFCI de l’État plurinational de Bolivie témoigne également d’une participation efficace de la société civile et a connu du succès grâce à son approche communautaire qui intègre les pratiques biomédicales et autochtones. Par exemple, le programme a introduit le vaccin anti-VPH en 2017 en appliquant une gamme d’approches axées sur la communauté, notamment l’échange d’information entre pairs, la promotion de la vaccination dans la communauté et des messages unifiés. Cette approche a conduit à une couverture vaccinale élevée et à un faible taux d’abandon lors de l’introduction du vaccin (44).
Comment les pays peuvent-ils accélérer les progrès ?
Il est important d’intensifier la participation de la société civile sur l’ensemble de la Région en vue d’éliminer les maladies. Les données probantes mettent en évidence l’impact positif de la participation communautaire dans la lutte contre les maladies transmissibles pour des problèmes de santé tels que le VIH, les infections sexuellement transmissibles, le paludisme, la tuberculose et la santé de la mère et de l'enfant (45). Bien que certains dispositifs de participation communautaire nécessitent d'être ajustés à chaque contexte, des stratégies conçues avec et pour des communautés données peuvent mieux renforcer l’éducation et la sensibilisation, ainsi que les capacités locales. Le recours à des approches souples et axées sur la communauté est essentiel pour permettre à la société civile de diriger les efforts de participation, tout en veillant à ce que ces initiatives répondent aux besoins et aux contextes uniques de chaque communauté. Encourager la création collaborative de stratégies avec la société civile peut favoriser une collaboration plus forte et des résultats plus durables.
Références
- Organisation panaméricaine de la Santé. Fact Sheet: EMTCT PLUS Initiative 2011–2021. Essential intervention for the prevention of MTCT early childhood transmission of hepatitis B. Washington, D.C. : OPS ; 2022. Disponible sur : https://www.paho.org/en/documents/fact-sheet-emtct-plus-initiative-2011-2021-essential-intervention-prevention-mtct-early.
- Organisation panaméricaine de la Santé. Belize, Jamaica and St. Vincent and the Grenadines eliminate mother-to-child transmission of HIV and syphilis. Washington, D.C. : OPS ; 2024 [consulté le 14 septembre 2024]. Disponible sur : https://www.paho.org/en/news/7-5-2024-belize-jamaica-and-st-vincent-and-grenadines-eliminate-mother-child-transmission-hiv.
- Organisation panaméricaine de la Santé. Suriname enhances malaria surveillance with specialized capacity building for community health workers. Washington, D.C. : OPS ; 2023 [consulté le 14 septembre 2024]. Disponible sur : https://www.paho.org/en/news/30-11-2023-suriname-enhances-malaria-surveillance-specialized-capacity-building-community.
- Organisation panaméricaine de la Santé. Épidémie de choléra en Haïti : les agents de santé communautaires (ASCP), piliers de la réponse sur le terrain. Washington, D.C. : OPS ; 2022 [consulté le 14 septembre 2024]. Disponible sur : https://www.paho.org/fr/histoires/epidemie-cholera-haiti-les-agents-sante-communautaires-ascp-piliers-reponse-sur-le.
- Organisation panaméricaine de la Santé. Building Resilient Health Systems to Advance toward Universal Health in the Americas: Lessons from COVID-19. Washington, D.C. : OPS ; 2022. Disponible sur : https://iris.paho.org/handle/10665.2/56444.
- Espinosa LM. Pandemia aceleró uso de la telesalud y se lograron más de 100 millones de citas virtuales. La Republica. 25 mai 2021 : Salud. Disponible sur : https://www.larepublica.co/especiales/la-salud-despues-del-covid/la-pandemia-acelero-el-uso-de-la-telemedicina-3175267.
- Fédération latino-américaine de l'industrie pharmaceutique. Recorrido por la telemedicina en América Latina. Mexico : Fifarma ; 2020.
- Camacho-Leon G, Faytong-Haro M, Carrera K, Molero M, Melean F, Reyes Y et collab. A narrative review of telemedicine in Latin America during the COVID-19 pandemic. Healthcare. 2022;10(8):1361. Disponible sur : https://doi.org/10.3390/healthcare10081361.
- Winny A. Chagas: the most neglected of neglected tropical diseases. Baltimore : École de santé publique Bloomberg de l’Université John Hopkins. 2022 [consulté le 14 septembre 2024]. Disponible sur : https://publichealth.jhu.edu/2022/chagas-the-most-neglected-of-neglected-tropical-diseases.
- Nogueira-Rodrigues A, Flores MG, Macedo Neto AO, Braga LAC, Vieira CM, de Sousa-Lima RM et collab. HPV vaccination in Latin America: coverage status, implementation challenges and strategies to overcome it. Front Oncol. 2022;12:984449. Disponible sur : https://doi.org/10.3389/fonc.2022.984449.
- Organisation panaméricaine de la Santé. Accroissement de la capacité de production des médicaments et des technologies de la santé essentiels [document CD59/INF/8]. 59e Conseil directeur de l'OPS, 73e session du Comité régional de l'OMS pour les Amériques ; du 20 au 24 septembre 2021. Washington, D.C. : OPS ; 2021. Disponible sur : https://www.paho.org/fr/documents/cd598-accroissement-capacite-production-des-medicaments-et-des-technologies-sante.
- Organisation panaméricaine de la Santé. Outil de monitorage de la performance du Programme élargi de vaccination – Feuille de calcul. Washington, D.C. : OPS ; 2024 [consulté le 16 septembre 2024]. Disponible sur : https://www.paho.org/fr/documents/outil-monitorage-performance-du-programme-elargi-dimmunisation-feuille-calcul.
- Organisation panaméricaine de la Santé. Countries approve policy to strengthen regulatory systems for medicines and other health technologies in the Americas. Washington, D.C. : OPS ; 2022 [consulté le 14 septembre 2024]. Disponible sur : https://www.paho.org/en/news/29-9-2022-countries-approve-policy-strengthen-regulatory-systems-medicines-and-other-health.
- Organisation mondiale de la Santé. Water sanitation and health: WASH and neglected tropical diseases. Genève : OMS ; 2023 [consulté le 16 septembre 2024]. Disponible sur : https://www.who.int/teams/environment-climate-change-and-health/water-sanitation-and-health/burden-of-disease/wash-and-neglected-tropical-diseases.
- World Vision International. Why water matters in HIV/AIDS. Monrovia, Californie : World Vision; [c2024] [consulté le 16 septembre 2024]. Disponible sur : https://www.wvi.org/clean-water-sanitation-and-hygiene-wash/why-water-matters-hivaids.
- Gaspard J, Usey MM, Fredericks-James M, Sanchez-Martin MJ, Atkins L, Campbell CH, et collab. Survey of schistosomiasis in Saint Lucia: evidence for interruption of transmission. Am J Trop Med Hyg. 2020;102(4):827–831. Disponible sur : https://doi.org/10.4269/ajtmh.19-0904.
- Garn JV, Wilkers JL, Meehan AA, Pfadenhauer LM, Burns J, Imtiaz R, et collab. Interventions to improve water, sanitation, and hygiene for preventing soil-transmitted helminth infection. Cochrane Database Syst Rev. 2022 Jun 21;6(6):CD012199. Disponible sur : https://doi.org/10.1002/14651858.cd012199.pub2.
- Organisation mondiale de la Santé. Mettre fin à la négligence pour atteindre les objectifs de développement durable : une stratégie mondiale pour l’eau, l’assainissement et l’hygiène afin de lutter contre les maladies tropicales négligées, 2021-2030. Genève : OMS ; 2021. Disponible sur : https://iris.who.int/handle/10665/365974.
- Organisation panaméricaine de la Santé. Tools for monitoring the coverage of integrated public health interventions. Vaccination and deworming of soil-transmitted helminthiasis. Washington, D.C. : OPS ; 2017. Disponible sur : https://iris.paho.org/handle/10665.2/34510.
- Organisation panaméricaine de la Santé. Countries of the Americas agree to increase genomic sequencing to detect potentially pandemic pathogens. Washington, D.C. : OPS ; 2022 [consulté le 14 septembre 2024]. Disponible sur : https://www.paho.org/en/news/28-9-2022-countries-americas-agree-increase-genomic-sequencing-detect-potentially-pandemic.
- Chame M, Barbosa HJC, Gadelha LMR, Augusto DA, Krempser E, Abdalla L. SISS-Geo: leveraging citizen science to monitor wildlife health risks in Brazil. J Healthc Inform Res. 2019; 3(4):414–440. Disponible sur : https://doi.org/10.1007%2Fs41666-019-00055-2.
- Organisation panaméricaine de la Santé. Factsheet: drug-resistant tuberculosis in the Americas Region, 2022. Washington, D.C. : OPS ; 2024. Disponible sur : https://www.paho.org/en/documents/factsheet-drug-resistant-tuberculosis-americas-region-2022.
- Organisation panaméricaine de la Santé. Plan d'action sur la résistance aux antimicrobiens : rapport final [document CD59/INF/10]. 59e Conseil directeur de l'OPS, 73e session du Comité régional de l'OMS pour les Amériques ; du 20 au 24 septembre 2021. Washington, D.C. : OPS ; 2021. Disponible sur : https://www.paho.org/fr/documents/cd59inf10-plan-daction-sur-resistance-aux-antimicrobiens-rapport-final.
- Organisation panaméricaine de la Santé. Réseau latino-américain et caribéen de surveillance de la résistance aux antimicrobiens - ReLAVRA+. Washington, D.C. : OPS ; [date non connue] [consulté le 16 septembre 2024]. Disponible en anglais sur : https://www.paho.org/en/topics/antimicrobial-resistance/latin-american-and-caribbean-network-antimicrobial-resistance.
- Organisation mondiale de la Santé. Social determinants of health. Genève : OMS ; [date non connue] [consulté le 14 septembre 2024]. Disponible sur : https://www.who.int/health-topics/social-determinants-of-health.
- Organisation mondiale de la Santé. Health inequality monitor: health equity assessment toolkit. Genève : OMS ; [date non connue] [consulté le 14 septembre 2024]. Disponible sur : https://www.who. int/data/inequality-monitor/assessment_toolkit.
- Organisation panaméricaine de la Santé. Monitoring and analysis: monitoring of targets and their inequalities. Washington, D.C. : OPS ; [date non connue] [consulté le 16 septembre 2024]. Disponible sur : https://opendata.paho.org/en/sdg3/monitoring-and-analysis/monitoring-of-targets-and-their-inequalities.
- Organisation mondiale de la Santé. Global tuberculosis report 2023 : tuberculosis in prisons. Genève : OMS ; 2023 [consulté le 14 septembre 2024]. Disponible sur : https://www.who.int/teams/global-tuberculosis-programme/tb-reports/global-tuberculosis-report-2023/featured-topics/tb-in-prisons.
- Organisation panaméricaine de la Santé. La santé des populations autochtones des Amériques. [résolution CD47.R18]. 47e Conseil directeur de l'OPS, 58e session du Comité régional de l'OMS pour les Amériques ; du 25 au 29 septembre 2006. Washington, D.C. : OPS ; 2006. Disponible sur : https://iris.paho.org/handle/10665.2/366.
- Organisation panaméricaine de la Santé. Intercultural, participatory approach key to ensuring health of Indigenous Peoples in the Americas. Washington, D.C. : OPS ; 2023 [consulté le 14 septembre 2024]. Disponible sur : https://www.paho.org/en/news/8-8-2023-intercultural-participatory-approach-key-ensuring-health-indigenous-peoples-americas.
- Organisation panaméricaine de la Santé. Integrating traditional midwives into Bolivia’s health care system to promote culturally secure births and intercultural dialogue. Washington, D.C. : OPS ; 2022 [consulté le 14 septembre 2024]. Disponible sur : https://www.paho.org/en/stories/integrating-traditional-midwives-bolivias-health-care-system-promote-culturally-secure.
- Organisation panaméricaine de la Santé. PAHO study sheds light on perceptions of COVID-19 vaccine among Colombian Indigenous communities. Washington, D.C. : OPS ; 2024 [consulté le 14 septembre 2024]. Disponible sur : https://www.paho.org/en/news/24-5-2024-paho-study-sheds- light-perceptions-covid-19-vaccine-among-colombian-indigenous.
- Casas Cruz HM, Pelcastre-Villafuerte BE, Arenas-Monreal L, Ruiz-Rodríguez M. Concerted model of healthcare for Awá Indigenous of Nariño, Colombia. Int J Environ Res Public Health. 2022;19(19):12250. Disponible sur : https://doi.org/10.3390%2Fijerph191912250.
- Organisation panaméricaine de la Santé. Tackling vaccine hesitancy with art and dialogue in Bolivia. Washington, D.C. : OPS ; 2023 [consulté le 14 septembre 2024]. Disponible sur : https://www.paho.org/en/stories/tackling-vaccine-hesitancy-art-and-dialogue-bolivia.
- Organisation panaméricaine de la Santé. One health. Washington, D.C. : OPS ; [date non connue] [consulté le 14 septembre 2024]. Disponible sur : https://www.paho.org/en/one-health.
- Organisation panaméricaine de la Santé. Une seule santé : une approche globale pour faire face aux menaces sanitaires liées à l’interface homme-animal-environnement [document CD59/9]. 59e Conseil directeur de l'OPS, 73e session du Comité régional de l'OMS pour les Amériques ; du 20 au 24 septembre 2021. Washington, D.C. : OPS ; 2021. Disponible sur : https://www.paho.org/fr/documents/cd599-une-seule-sante-une-approche-globale-pour-faire-face-aux-menaces-sanitaires-liees.
- Organisation panaméricaine de la Santé. Climate change and health. Washington, D.C. : OPS ; [date non connue] [consulté le 14 septembre 2024]. Disponible sur : https://www.paho.org/en/topics/climate-change-and-health.
- Maciel ELN, Sanchez MN, Cruz AMD, Cravo Neto DB, Lima NVT. Brazil’s pivotal moment in public health: establishing the Interministerial Committee (CIEDDS) for the Elimination of Tuberculosis and Socially Determined Diseases. Rev Soc Bras Med Trop. 2024;57:e006012024. Disponible sur : https://doi.org/10.1590/0037-8682-0597-2023.
- Organisation panaméricaine de la Santé. El Salvador da un paso adelante en la iniciativa de Eliminación de las Enfermedades. Washington, D.C. : OPS ; 2024 [consulté le 14 septembre 2024]. Disponible sur : https://www.paho.org/es/noticias/16-2-2024-salvador-da-paso-adelante-iniciativa-eliminacion-enfermedades.
- Organisation panaméricaine de la Santé. Honduras avanza hacia la eliminación de enfermedades. Washington, D.C. : OPS ; 2024 [consulté le 14 septembre 2024]. Disponible sur : https://www.paho.org/es/noticias/12-7-2024-honduras-avanza-hacia-eliminacion-enfermedades.
- Centre Carter. Onchocerciasis Elimination Program for the Americas (OEPA). Atlanta : Centre Carter ; [c2024] [consulté le 16 septembre 2024]. Disponible sur : https://www.cartercenter.org/health/river_blindness/oepa.html.
- Organisation panaméricaine de la Santé. Recommendations of the 17th Inter-American Ministerial Meeting on Health and Agriculture: One Health and the Sustainable Development Goals. RIMSA 17 ; 21 et 22 juillet 2016 ; Asunción. Washington, D.C. : OPS ; 2016. Disponible sur : https://iris.paho.org/handle/10665.2/51520.
- Joudyian N, Doshmangir L, Mahdavi M, Tabrizi JS, Gordeev VS. Public-private partnerships in primary health care: a scoping review. BMC Health Serv Res. 2021;21(1):4. Disponible sur : https://doi.org/10.1186/s12913-020-05979-9.
- Organisation panaméricaine de la Santé. Promoting immunization equity in the Americas. Intersectoral collaboration, civil society participation, and community engagement: Sucre, Bolivia (Plurinational State of). Washington, D.C. : OPS ; 2021. Disponible sur : https://iris.paho.org/handle/10665.2/54186.
- Questa K, Das M, King R, Everitt M, Rassi C, Cartwright C, et collab. Community engagement interventions for communicable disease control in low- and lower- middle-income countries: evidence from a review of systematic reviews. Int J Equity Health. 2020;19(1):51. Disponible sur : https://doi.org/10.1186/s12939-020-01169-5.
SUJET ACTUEL
CHAPITRES
- Résumé d'orientation
- Présentation générale de l'Initiative d'élimination des maladies
- Progrès régionaux vers les cibles d’élimination des maladies
- Perspectives sur les interventions propres à des maladies spécifiques
- Comment accélérer les efforts d'élimination dans la Région
- Parvenir a l'elimination




